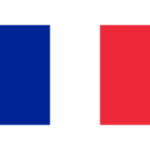Mémoire des pierres
Juliette Le Roux
Adrien Basse-Cathalinat
Juliette Le Roux et Adrien Basse-Cathalinat, même s’ils ne sont pas des touristes, pourraient reprendre à leur compte ce propos de l’illustre photographe labruguiérois. Les clichés de paysages montagneux, que ce soit ceux du Kirghizstan pour Juliette Le Roux ou ceux des Pyrénées pour Adrien Basse-Cathalinat, sont le fruit d’une méditation sur les relations entre l’homme et son territoire, celle-ci n’ayant pu émerger que dans un processus long de confrontation physique à des territoires rudes et abruptes.
Dernier opus d’un cycle de trois expositions sur l’environnement (végétal avec l’exposition « Ronds de lune » au premier trimestre 2019, animal avec la dernière édition du festival A ciel ouvert) c’est le minéral, et plus particulièrement le paysage de montagne, qui est au cœur du travail ces deux jeunes photographes présentés à L’Espace photographique Arthur Batut.
Juliette Le Roux
Voyage et photographie sont indissociables dans la démarche photographique de cette jeune artiste qui, pour l’exposition à Labruguière présente Le bruit des pierres, ensemble de trois séries en noir et blanc réalisées en 2017 lors d’une voyage au Kirghizstan, et Nós somos o caminho, une série de photographies en couleur et noir et blanc issues de rencontres avec des pèlerins à l’occasion d’une marche de 250 km sur les chemins de St-Jacques au Portugal.Le bruit des pierres
Juliette Le Roux s’intéresse aux roches et les photographie. Au Kirghizstan, où elle a voyagé d’octobre à décembre 2017, les hautes montagnes, les pistes, les pierres gravées ou encore celles utilisées pour la construction, l’ont interpellée. Le sentiment qu’en cette matière minérale résidait une autre histoire qu’on ne saurait dire en langage humain a guidé ses pas et son objectif. Ces roches, porteuses de mémoires millénaires, gardiennes d’histoire et de savoir, sont manipulées et transformées par la main de l’homme : elles racontent et taisent à la fois.
« Le bruit des pierres » se décline en trois séries de photographies noir et blanc :
Pierres millénaires : Le Kirghizstan est un pays de montagnes, bordé par la chaîne Tian Shan. Les monts sont situés au sud-est de la mer intérieure que forme le lac salé d’Yssik Koul. Cette série propose une vision des Montagnes Célestes avec ses paysages rocailleux et arides.
Pierres urbaines : A Karakol et à Semenovka, deux territoires en plein développement urbain, les constructions témoignent de l’omniprésence de la pierre dans le bâti, qu’il soit ancien ou moderne.
Pierres sacrées : Blocs de pierres et pétroglyphes renvoient dans cette série à la dimension magique du rapport de l’homme à son environnement. Ce sont en quelque sorte les traces des échanges que l’homme a entretenu dans des temps retirés avec le surnaturel.
Nós somos o caminho
« La série d’images présentée ici est le fruit de la rencontre avec des pèlerins qui ont effectué le même parcours et dont le corps a éprouvé l’expérience de la marche et en portent les traces : Nós somos o caminho, (Nous sommes le chemin) ».
Les chemins de Compostelle sont les itinéraires empruntés par les pèlerins pour se rendre à Saint-Jacques de-Compostelle, au nord de l’Espagne. Itinéraire culturel, ce pèlerinage participe à la valorisation de l’histoire, du patrimoine et de la mémoire commune européenne. Au Portugal, plusieurs tracés cheminent jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, et ce sont plus de 65 000 pèlerins qui empruntent chaque année ces voies et parcourent un long voyage avec au départ une intention et un intérêt particulier.
Je suis partie sur les Chemins de Compostelle avec un sac à dos, au départ d’Oporto. J’ai marché une distance d’environ 250 km à pieds. Je vivais en extérieur et les cycles de marche rythmaient mon quotidien. La marche, c’est un mouvement au rythme relativement lent, qui s’articule entre flux et reflux. On est dans l’espace, on s’y tient dans la verticalité. On s’inscrit ainsi dans un territoire, et on y prend physiquement part. C’est l’expérience d’une réalité géographique. Plastique, notre corps s’adapte et se transforme. Sous la voûte plantaire se dessine aussi les Chemins.
J’ai emporté lors de ce voyage un appareil argentique Canon EOS 1000 et des pellicules couleurs et noir et blanc, avec l’intention de documenter ma marche. La prise d’une image amène un dialogue, entre le mouvement et l’arrêt, entre la personne qui s’immobilise devant l’objectif et celle qui fabrique l’image.

Arthur Batut, un précurseur
"Au 19ème siècle, l’histoire de la photographie est passée par Labruguière" Jean Dieuzaide
Le personnage
Né à Castres en 1846, Arthur BATUT passe sa vie à Labruguière dans sa propriété d’En Laure.
Ses goûts pour la recherche, l’amènent à s’intéresser à l’histoire, l’archéologie et surtout à la photographie, recherchant des applications à cet art "d'écrire avec la lumière" dont il est un ardent défenseur.
Il passe des années à travailler sur la formation de l'identité par la photographie et le portrait-type, puis sur la photo aérienne par cerf-volant.
"Cet aimable fantaisiste, mais rigoureux dans ses recherches solitaires dans son midi, a passé sa vie à se faire plaisir " selon sa dernière petite fille.
Il faut bien admettre qu’Arthur Batut avait su porter un regard de visionnaire sur la photographie.
Il est décédé En Laure, à 72 ans, en 1918, d’une attaque d’apoplexie.
Sa famille, son éducation
Arthur Batut naît en 1846 dans un contexte favorable à l’épanouissement de sa riche personnalité. Son père est un commerçant aisé, qui a fait de brillantes études à l’école royale de Sorèze. Sa mère, Marie Barthes, est d’une honorable famille protestante de Mazamet. Une famille bourgeoise qui lui transmettra une grande rigueur morale et une éducation de fin lettré, bachelier du collège de Castres.
Le domaine d’En Laure est une propriété familiale située à Labruguière où Arthur Batut passe les moments agréables de son enfance. Il le reçoit comme cadeau de mariage de sa grand-mère paternelle. Il va désormais y passer la plus grande partie de sa vie. Il améliore le domaine : irrigation, agronomie… et en fait une exploitation rentable qui va lui procurer une existence aisée et lui permettre de satisfaire sa curiosité, son génie inventif. Il collecte des objets antiques, et publie diverses études. Il sera nommé Archiviste des Antiquités de Castres et du département du Tarn.
Il explore la région, à cheval, mais surtout à pied, et devient un adepte, un précurseur du camping.

En cours
" Le temps des moissons " Arthur Batut et Félix Arnaudin jusqu'au 27 février 2021
Félix Arnaudin, issu comme Arthur Batut d’une famille de la bourgeoisie locale, est à la fois linguiste, folkloriste, historien, ethnologue, photographe et écrivain. Il consacre toute son énergie et sa maigre fortune à l'étude des traditions populaires du pays des Landes de Gascogne. Conscient de la mutation agricole, économique et sociale dans laquelle son territoire est engagé depuis la promulgation de la loi du 19 juin 1857 « relative à l’assainissement et la mise en culture des landes de Gascogne », il s’attache à collecter, rassembler et ordonner tout un patrimoine rural matériel et immatériel, menacé de disparition. Sa pratique photographique est un des versants de cette collecte mais elle ne se réduit pas à une pratique purement documentaire : elle intègre une dimension esthétique sur laquelle l’exposition revient largement.
D’Arthur Batut, on connait surtout le pionnier de la photographie appliquée au domaine scientifique avec notamment l’invention de la photographie avec un cerf-volant et la pratique du portrait-type. On sait un peu moins que ses revenus provenaient de l’exploitation de terres appartenant à sa famille et à celle de sa femme Blanche Tournier, qui leur ont été léguées à l’occasion de leur mariage en 1868. Jusqu’à la fin de sa vie, Arthur Batut gère ce domaine avec l’aide de métayers répartis sur des propriétés autour d’En Laure à Labruguière et de Laprade dans la Montagne Noire. Parmi les quelques 4000 clichés que le photographe labruguièrois nous a laissés, entre 200 et 300 donnent à voir les travaux liés à l’exploitation du foin, principale activité du domaine, mais aussi celle du bois et l’élevage.